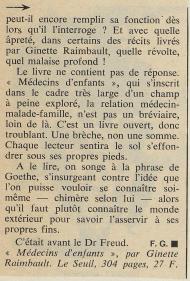Témoignage d'une pédiatre s'interroge sur la relation médecin-malade-famille, en déchiffrant sa conduite et celle de ses pairs, dans le livre « Médecins d'enfants »
LIVRES
Qui soigne qui ?
Pendant cinq ans, onze pédiatres ont tenté, ensemble, de déchiffrer leur propre conduite : De ces discussions, le Dr Ginette Raimbault a tiré un livre troublant.
Ainsi les anges ont un sexe.
Beaucoup de patients seront étonnés de l'apprendre : les médecins sont, dans leur pratique, des hommes, des femmes, des personnes vulnérables, lourdes d'un père, d'une mère, d'une histoire familiale, lestées d'un psychisme personnel qu'ils ne peuvent pas déposer au vestiaire de l'hôpital ou de leur cabinet de consultation, le voudraient-ils. Ils abritent des fantasmes, les nourrissent, les projettent, et se conduisent, en somme, comme chacun de nous.
D'abord, pourquoi ont-ils choisi d'être médecins ? Et singulièrement médecins d'enfants ? Répondre à cette question, c'est déjà accepter de se mettre en question.
Onze pédiatres l'ont fait, pendant cinq ans, au cours de réunions hebdomadaires dans une salle de l'hôpital des Enfants-Malades. Par le jeu de discussions de groupe, implacables et souvent agressives, ils ont entrepris d'élucider leur conduite, en racontant, concrètement et simplement, un certain nombre de cas, tirés au sort, où ils se trouvaient impliqués. Silencieuse, et sans visée thérapeutique, une analyste de l'Ecole freudienne de Paris, le Dr Ginette Raimbault, maître de recherches à l'Inserm, les écoutait, intervenant à peine.
Sous la peau des mots. Ce sont les récits faits, par ces onze médecins d'enfants, à la recherche de leurs propres blocages, qui constituent le livre exceptionnel publié aujourd'hui par Ginette Raimbault.
Entre le pédiatre, l'enfant malade et les parents, une relation s'institue, mais laquelle ? Qui demande quoi à qui ? La mère qui vient consulter pour son enfant nerveux, quel secours vient-elle en vérité implorer pour elle ? Et quelle réponse le pédiatre doit-il, peut-il donner — à supposer qu'il ait su entendre le véritable discours de la mère sous la peau des mots ?
« Parfois, dans mes relations heureuses avec les mères, je me sens la possibilité de dispenser du bonheur », avoue un pédiatre. Et un autre : « C'est curieux : voilà trois médecins femmes qui donnent des observations de trois couples, et dans les trois — est-ce le fait du hasard ? — nous avons une drôle de manière de présenter le mari. »
« Médecins d'enfants » a pour objet de montrer comment ces « drôles de manières » — ou d'autres — se répercutent dans la pratique quotidienne du pédiatre.
Mais, alors, ni analyste (ce n'est pas son métier), ni plombier (il ne suffit pas de réparer une tuyauterie abîmée du côté de la gorge ou de l'intestin), ni policier (le maintien de l'ordre et l'intégration de l'enfant dans cet ordre social n'est pas son affaire), comment le pédiatre, de plus en plus sollicité, peut-il encore remplir sa fonction dès lors qu'il l'interroge ? Et avec quelle âpreté, dans certains des récits livrés par Ginette Raimbault, quelle révolte, quel malaise profond !
Le livre ne contient pas de réponse. « Médecins d'enfants », qui s'inscrit dans le cadre très large d'un champ à peine exploré, la relation médecin-malade-famille, n'est pas un bréviaire, loin de là. C'est un livre ouvert, donc troublant. Une brèche, non une somme. Chaque lecteur sentira le sol s'effondrer sous ses propres pieds.
A le lire, on songe à la phrase de Goethe, s'insurgeant contre l'idée que l'on puisse vouloir se connaître soi-même — chimère selon lui — alors qu'il faut plutôt connaître le monde extérieur pour savoir l'asservir à ses propres fins.
C'était avant le Dr Freud.
F. G.
La mère coupable
« J'ai eu René ; on l'a trop gâté, il est insupportable, il casse tout à la maison, il a une conduite de bébé. » Pendant qu'elle parlait, ce petit garçon de 5 ans et demi essayait de l'embrasser et de monter sur ses genoux, et elle lui disait : « Tu m'embêtes, vat-en », et le gosse la regardait, l'air très malheureux.
Elle repoussait cet enfant qui essayait de l'embrasser, alors qu'elle-même se plaignait de ne pas avoir été embrassée par son père. Elle reproduisait l'attitude de ses parents. Cela, j'aurais aimé le lui faire comprendre. » (Page 231.)
« J'ai eu cette semaine une femme qui est venue me voir en me disant : « Je ne sais pas pourquoi je vous amène mon enfant. » P'est déjà assez symp- tomatique et intéressant a priori. Puis, en l'écoutant pendant dix minutes, j'ai vu que ce fils qui avait 7 ou 8 ans était complètement fixé à sa mère, et inversement, et qu'elle rejetait totalement son mari. Je les ai vus pendant une demi-heure — je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette histoire. »
« Ce médecin ne sait pas ce qu'il adviendra de cette histoire — peutêtre en serat-elle modifiée, d'ailleurs, de par cette consultation — en tout cas mère et fils n'ont pas été rejetés ensemble parce que « non malades ». (Page 288.)
« La culpabilité de la mère, je la retrouvais à chacune de nos rencontres. Elle venait toujours avec un enfant fatigué, fébrile, infecté depuis plusieurs jours, et chaque fois tête basse « C'est de ma faute, j'aurais dû venir plus tôt. » Ma « sanction » était régulièrement une ordonnance massive d'antibiotiques : il fallait bien soigner l'enfant. Cette situation qui rendait nos relations impossibles se reproduisait à chaque consultation. Deux faits particuliers caractérisaient celle-ci : Mme P. désirait payer chaque acte médical, même un conseil pour un enfant non examiné, ou la pose d'un pansement ; elle exigeait, d'autre part, l'octroi de ce paiement avec une certaine colère.
Docteur Sienne : « Elle ne veut rien vous devoir... c'est pour elle une façon de dire : « Je ne suis pas si pauvre, nous avons des vies différentes. » (Pages 220- 221.)