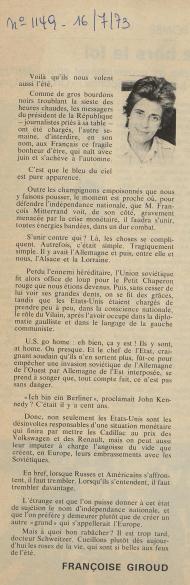Phase de rapprochement entre USA et URSS, Giroud critique le discours gouvernementale qui se veut alarmiste qui voit une menace pour l'indépendance nationale. Ironise.
Voilà qu'ils nous volent aussi l'été.
Comme de gros bourdons noirs troublant la sieste des heures chaudes, les messagers du président de la République — journalistes priés à sa table — ont été chargés, l'autre semaine, d'interdire, en son nom, aux Français ce fragile bonheur d'être, qui naît avec juin et s'achève à l'automne.
C'est que le bleu du ciel est pure apparence.
Outre les champignons empoisonnés que nous y faisons pousser, le moment est proche où, pour défendre l'indépendance nationale, que M. François Mitterrand voit, de son côté, gravement menacée par la crise monétaire, il faudra s'unir, toutes énergies bandées, dans un dur combat.
S'unir contre qui ? Là, les choses se compliquent. Autrefois, c'était simple. Tragiquement simple. Il y avait l'Allemagne et puis, entre elle et nous, l'Alsace et la Lorraine.
Perdu l'ennemi héréditaire, l'Union soviétique fit alors office de loup pour le Petit Chaperon rouge que nous étions devenus. Puis, sans cesser de lui voir ses grandes dents, on se fit des grâces, tandis que les Etats-Unis étaient chargés de prendre peu à peu, dans la conscience nationale, le rôle du Vilain, après l'avoir occupé dans la diplomatie gaulliste et dans le langage de la gauche communiste.
U.S. go home : eh bien, ça y est ! Ils y sont, at home. Ou presque. Et le chef de l'Etat, craignant soudain qu'ils n'en sortent plus, fût-ce pour empêcher une invasion soviétique de l'Allemagne de l'Ouest par Allemagne de l'Est interposée, se prend à songer que, tout compte fait, ce n'est pas sans danger.
« Ich bin ein Berliner », proclamait John Kennedy ? C'était il y a cent ans.
Donc, non seulement les Etats-Unis sont les désinvoltes responsables d'une situation monétaire qui finira par mettre les Cadillac au prix des Volkswagen et des Renault, mais on peut aussi leur imputer à charge l'angoisse du vide que créent, en Europe, leurs embrassements avec les Soviétiques.
En bref, lorsque Russes et Américains s'affrontent, il faut trembler. Lorsqu'ils s'entendent, il faut trembler davantage.
L'étrange est que l'on puisse donner à cet état de sujétion le nom d'indépendance nationale, et que l'on préfère y demeurer plutôt que de créer un autre « grand » qui s'appellerait l'Europe.
Mais à quoi bon rabâcher? Il est trop tard, docteur Schweitzer. Cueillons plutôt dès aujourd'hui les roses de la vie, qui sont si belles aux feux de l'été.
Mardi, octobre 29, 2013
L’Express
politique internationale