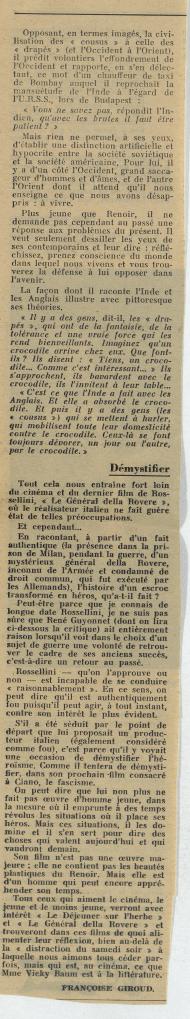Réflexion sur la jeunesse à partir des derniers films de Renoir et de Rossellini
En interrogeant les derniers films de Renoir et de Rossellini, Françoise Giroud répond.
L'année dernière, il n'y en avait que pour eux. Cette année, ce sont les pelés, les galeux d'où vient tout le mal...
Que leur est-il donc arrivé aux « jeunes » du cinéma français ? Rien, en tout cas, dont ils soient responsables.
Si certains producteurs de films ont été assez légers pour croire à une génération spontanée d'infaillibles petits génies économes, parce que Louis Malle, Claude Chabrol, François Truffaut, Jacques Baratier ont effectivement manifesté du talent à peu de frais, tant pis pour eux. Qu'ils apprennent leur métier.
Grâce à ces jeunes hommes, le cocotier a été fortement secoué, comme il le fut pendant la guerre lorsque la génération Clouzot, Becker, Autant-Lara, Bresson réussit sa percée.
Ceux-ci n'ont pas empêché René Clair et Renoir de reprendre et de poursuivre leur carrière en France après la guerre. Mais ils ont scié les branches sur lesquelles se reposaient les médiocres ou les usés de la même génération.
Nous assistons à un phénomène analogue. Il est dans l'ordre des choses. Pendant quelques mois, il peut y avoir eu confusion des valeurs, engouement ou dénigrement excessifs. Et puis les films des uns et des autres sortiront et chacun se retrouvera à sa place. Ceux qui n'avaient pour eux que le crédit soudain accordé à la jeunesse s'effondreront seuls. Les coups de pied aux morts sont inutiles. Et les réalisateurs de films n'ont pas à être appréciés comme les vins, en fonction de leur millésime.
L'âge triomphant
Mais il suffit de voir à Paris, cette semaine, le dernier film de Jean Renoir (65 ans) et celui de Rossellini (53 ans) pour constater que, maladroite ou aboutie, la création n'est jamais indépendante de l'âge du créateur.
Bien que plus de dix années les séparent, Renoir et Rossellini sont en beaucoup de points comparables.
Ils sont tous deux parmi les très rares « anciens » que les « nouveaux » reconnaissent pour maîtres. Ils ont consenti le minimum de concessions ; ils ont préservé au maximum leur indépendance ; ils ont eu leur lot de triomphes et d'échecs ; ils ont enfin, l'un et l'autre, découvert l'Inde, sa civilisation et sa philosophie à cette époque de l'existence où tout homme, parvenu au faite d'une carrière, s'arrête et, avant de prendre un nouveau souffle, se retourne pour considérer son passé et se demande : « Qu'ai-je fait de ma vie ? »
Ils ont été tous deux « progressistes » au sens généreux du terme, obsédés d'humanisme.
Face à l'Inde, misérable, mais sereine, ils ont constaté l'échec des sociétés occidentales chrétiennes et hautement industrialisées sur ce qu'ils tiennent pour essentiel : le bonheur de l'homme. Et ils crient.
Ce ne sont point là soucis de jeunes gens.
« Le Déjeuner sur l'herbe », conçu et réalisé par Jean Renoir, est en tous points le film d'un homme d'âge.
D'une part, on y trouve une indépendance d'écriture, et de ton — une indépendance tout court — qui ne s'acquiert qu'au-delà du succès.
« Le Déjeuner » est, à un film de facture classique, ce qu'un récit parlé est à un récit élaboré. Dans une libre conversation, le narrateur va, vient, vagabonde, ne termine pas toujours ses phrases ; il ne suit pas de plan, il s'étend trop ici, il abrège trop là. S'il a de la verve, il tient sous le charme. Veut-on résumer ou reproduire son propos ? Parfois, il n'en reste rien. Mais pendant qu'il parle, il est présent, présent comme aucun écrivain ne le sera jamais.
Cette liberté d'allure, c'est celle d'un homme qui a dépassé toutes les contraintes formelles.
C'est l'âge, triomphant.
Mais il y a le sujet, et surtout la façon dont il est abordé.
Renoir met en scène un célèbre biologiste, rigoureusement rationaliste et promoteur convaincu de l'insémination artificielle dont il attend les plus heureux effets pour l'amélioration de la race. Paul Meurisse lui donne son visage.
L'obscurantisme
Face à ce biologiste et à son entourage imbu de science pour des raisons parfois moins élevées, un vieux berger qui déclenche les tempêtes à volonté lorsqu'il joue de la flûte, une fille de la nature, drue, saine et sentant encore la terre, et la famille de cette aimable créature. Une nouvelle venue, Catherine Rouvel, donne à ce personnage une fraîche et authentique saveur.
Vous avez compris la suite : toutes les théories du biologiste s'effondreront devant les « miracles » qu'accomplit le vieux berger et la tendresse charnue de la fille des bois, qui fera une parfaite « femme au foyer » dont le modèle nous est, par ailleurs, présenté : quatre enfants morveux pendus aux basques d'une mère nageant dans la joie parce que son mari la rudoie et se fait servir à table.
Ce que Jean Renoir sait faire d'une caméra — et même de cinq caméras utilisées selon une technique qui fut fort en usage au début du parlant — de la couleur, d'un vrai corps de femme (et ce que le tournage « à l'économie » lui coûte comme à tout le monde en mauvaises « transparences » et en faux raccords) n'est pas en cause ici.
C'est l'esprit du film qui, venant de lui, fascine et contraint à se demander : « Quand cesse-t-on d'être jeune ? » A quel âge ?
Aucune information là-dessus. Chez les uns, c'est à trente ans, chez d'autres à quatre-vingts.
Mais la manifestation en est toujours la même. Il semble que tout individu atteigne, à un certain moment de sa vie, un seuil qu'il ne pourra plus franchir et à partir duquel il ne peut plus apprendre, il ne peut plus ni appréhender l'incessante évolution du monde, ni s'y adapter. Tout se passe comme si l'avenir se dérobait devant lui.
Que Renoir, homme de progrès, ressente et exprime la menace que le machinisme, la désindividualisation, le sectarisme, l'obsession de l'efficacité - scientifique font peser sur l'homme, rien de plus naturel.
Qu'il y réponde — fût-ce sur le mode humoristique — par une apologie de l'obscurantisme surprend.
Ce que devait être la réponse ? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien, si chacun sent qu'il devient urgent de la trouver et de s'appliquer en tout cas à la chercher. Mais on ne guérit pas du progrès par son contraire.
« Le Déjeuner sur l'herbe » peut divertir ; certaines images sont d'une rare qualité esthétique ; la séquence où le vent déchaîné par la flûte du berger fait lever en même temps la houle des sens dans ces corps si sûrs d'être civilisés peut figurer dans les anthologies. Il reste que ce film ne saurait, ni pour le meilleur ni pour le pire, passer pour l'œuvre d'un jeune homme.
Roberto Rossellini, lorsqu'il parle, est plus violent que Renoir dans sa critique de la société occidentale et des mythes qu'elle a sécrétés.
Opposant, en termes imagés, la civilisation des « cousus » à celle des « drapés » (et l'Occident à l'Orient), il prédit volontiers l'effondrement de l'Occident et rapporte, en s'en délectant, ce mot d'un chauffeur de taxi de Bombay auquel il reprochait la mansuétude de l'Inde à l'égard de l'U.R.S.S., lors de Budapest :
« Vous ne savez pas, répondit l'Indien, qu'avec les brutes il faut être patient ? »
Mais rien ne permet, à ses yeux, d'établir une distinction artificielle et hypocrite entre la société soviétique et la société américaine. Pour lui, il y a d'un côté l'Occident, grand saccageur d'hommes et d'âmes, et de l'autre l'Orient dont il attend qu'il nous enseigne ce que nous avons désappris : à vivre.
Plus jeune que Renoir, il ne demande pas cependant au passé une réponse aux problèmes du présent. Il veut seulement dessiller les yeux de ses contemporains et leur dire : réfléchissez, prenez conscience du monde dans lequel nous vivons et vous trouverez la défense à lui opposer dans l'avenir.
La façon dont il raconte l'Inde et les Anglais illustre avec pittoresque ses théories.
« Il y a des gens, dit-il, les « drapés », qui ont de la fantaisie, de la tolérance et une vraie force qui les rend bienveillants. Imaginez qu'un crocodile arrive chez eux. Que font ils ? Ils disent : « Tiens, un crocodile... Comme c'est intéressant... » Ils s'approchent, ils bavardent avec le crocodile, ils l'invitent à leur table...
« C'est ce que l'Inde a fait avec les Anglais. Et elle a absorbé le crocodile. Et puis il y a des gens (les « cousus ») qui se mettent à hurler, qui mobilisent toute leur domesticité contre le crocodile. Ceux-là se font toujours dévorer, un jour ou l'autre, par le crocodile. »
Démystifier
Tout cela nous entraîne fort loin du cinéma et du dernier film de Rossellini, « Le Général della Rovere », où le réalisateur italien ne fait guère état de telles préoccupations.
Et cependant...
En racontant, à partir d'un fait authentique (la présence dans la prison de Milan, pendant la guerre, d'un mystérieux général della Rovere, inconnu de l'Armée et condamné de droit commun, qui fut exécuté par les Allemands), l'histoire d'un escroc transformé en héros, qu'a-t-il fait ?
Peut-être parce que je connais de longue date Rossellini, je ne suis pas sûre que René Guyonnet (dont on lira ci-dessous la critique) ait entièrement raison lorsqu'il voit dans le choix d'un sujet de guerre une volonté de retrouver le cadre de ses anciens succès, c'est-à-dire un retour au passé.
Rossellini — qu'on l'approuve ou non —- est incapable de se conduire « raisonnablement ». En ce sens, on peut dire qu'il est authentiquement fou puisqu'il peut agir, à tout instant, contre son intérêt le plus évident.
S'il a été séduit par le point de départ que lui proposait un producteur italien (également considéré comme fou), c'est parce qu'il y voyait une occasion de démystifier l'héroïsme. Comme il tentera de démystifier, dans son prochain film consacré à Giano, le fascisme.
On peut dire que lui non plus ne fait pas oeuvre d'homme jeune, dans la mesure où il emprunte à des temps révolus les situations où il place ses héros. Mais ces situations, il les domine et il s'en sert pour dire des choses qui valent aujourd'hui et qui vaudront demain.
Son film n'est pas une œuvre majeure ; elle ne contient pas les beautés plastiques du Renoir. Mais elle est d'un homme qui peut encore appréhender son temps.
Tous ceux qui aiment le cinéma, le jeune et le moins jeune, verront avec intérêt « Le Déjeuner sur l'herbe » et « Le Général della Rovere » et trouveront dans ces films de quoi alimenter leur réflexion, bien au-delà de la « distraction du samedi soir » à laquelle nous aimons tous céder parfois, mais qui est, au cinéma, ce que Mme Vicky Baum est à la littérature.